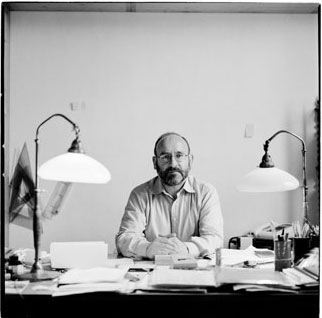
D.R.
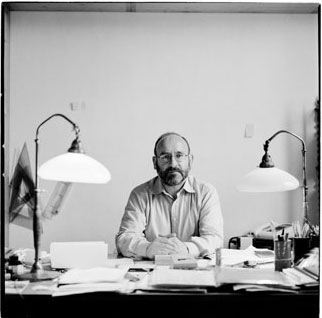
Imaginez un compositeur qui ressent le besoin d'un nouveau style de chant, alors qu'il est presque parvenu à mi-chemin de son art. Or, la voix ne figurait alors qu'occasionnellement dans le panorama musical de l'époque, y jouant un rôle presque marginal - du moins c'est ce qui semblait à ce compositeur ; il n'en allait pas autrement dans ses propres travaux.
Mais déjà, dissimulé dans un coin de sa conscience et prêt à se réveiller, on aurait pu trouver le germe d'un projet esthétique rempli de courage. Quand il n'y a pas de chant dans une œuvre musicale, on ressent un vide, un manque de présence humaine de premier plan. Il se présentait donc à moi une question que je ne parvenais pas à élucider, une question d'identité et d'aliénation.
Comment aller à la rencontre d'un style qui n'existe pas encore ? Il faut alors le construire, ou plutôt l'inventer. Un style ne doit pas rester au niveau du rêve, il doit se construire au fur et à mesure de la composition, avec humilité et ambition. Il me fallait chercher à pénétrer les infinies possibilités que nous offre le langage, dont le caractère est essentiellement combinatoire, puis en vérifier les résultats, opus après opus. Je me suis attaqué à cette entreprise il y a plus de vingt-cinq ans.
Et il m'a fallu me libérer sans attendre des automatismes de composition d'alors, directement ou indirectement issus de la tradition, qu'elle fût ancienne ou contemporaine. M'en libérer de façon à éviter indifférence et banalité ; trouver une nouvelle expression, c'est-à-dire dépasser et pourfendre la tradition.
J'ai d'ailleurs retrouvé dans mes papiers un texte que j'avais écrit à l'époque : Le chant - une union mystérieuse et puissante entre le son et les mots. Les mots et le son, le son et les mots : voilà ce qu'est chanter. Pour inventer un chant, il ne suffit pas de composer pour la voix. Il faut d'abord se purger l'esprit, obtenir la transparence des intervalles qui ont été traversés par toute la musique du monde, par des montagnes d'airs et de chansons, tout ce qui constitue la gigantesque décharge musicale au milieu de laquelle nous vivons.
Qui dit écologie dit naissance d'une conscience, qui demande d'agir dans le renouvellement. Donc, quand on parle d'écologie du son, on se réclame d'un certain retour au silence, mais surtout de retrouvailles avec une expression qui ne sera ni aride ni emphatique. Quand la voix se tait pour se confier au silence, il ne reste plus qu'une bouche, des cavités, de la salive. Des lèvres entr'ouvertes. Les limites d'un vide obscur, la frontière de la soif et de la faim (texte de 2005). C'est la corporéité qui se manifeste dans les dernières lignes de ce texte qui peut nous faire entrer tout droit dans la dramaturgie particulière que cette musique veut lancer.
Certains vers caractéristiques de l'espèce humaine se prêtent à la transposition vers le chant, parce qu'ils ont déjà une nature sonore, parce qu'ils sont recherchés, comme ceux du lamento au sens général ; ou encore les pleurs, qui ne sont séparés du rire que par une distance ambiguë (par exemple, dans mon opéra Persée et Andromède, dans lequel tout le final est configuré sur l'articulation du sanglot).
A la différence des autres compositeurs, ce qui m'intéresse, c'est placer l'auditeur au centre de la perception, l'entourer de signes comportementaux catégoriques. C'est-à-dire produire les conditions dans lesquelles l'esprit de celui qui écoute s'active et commence, à son tour, à produire des images d'une immédiateté irrésistible. Quand cela se fera-t-il, si ce n'est à présent ? Où cela se fera-t-il, si ce n'est ici ?
Qui le fera, si ce n'est toi ? Telle se raconte ma musique à celui qui l'écoute. Elle parle d'une rencontre et d'une invitation : ouvre ton esprit, prend conscience. Ou simplement : suis-moi. Je conduis l'auditeur au sein de la musique, pour le stimuler par des événements minuscules. Ils attirent son attention, ils ont une périodicité irrégulière et suspendue qui suscite en chaque personne l'illusion d'un environnement vital.
C'est une innovation perspective radicale, car elle implique la mise en jeu de codes de perception profonds et confère à l'auditeur un autre rôle : de témoin, il devient spectateur, il participe à des choses qui le touchent directement. Un rayon de lumière qui aveugle, et nous voilà présents sur la scène musicale ; si la tragédie commence ensuite, nous assistons à des épisodes pleins de tensions, à des actes sanglants, et notre présence en devient plus exposée et plus sensible.
Ce n'est pas un hasard si la volonté de casser la frontière qui existe habituellement entre l'œuvre d'art de la vie est l'aspect qui risque de rendre ma musique problématique pour certains. Tout au long d'une production compacte et conséquente, au fil des ans j'ai opéré une réduction drastique, une élimination de tout le superflu, à travers un jeu de stases, d'ombres et de lumières sonores - la scène se réduit à des figures, à des visages, à des objets essentiels, qui placent nécessairement le spectateur au centre des événements. Je comparerai cela aux gros plans de cinéma, tout en sachant qu'au théâtre il ne peut y avoir de zooms que psychologiques.
Entre les différents personnages se dévident d'étranges dialogues non dialogués, exacerbés par des pauses. Tout appel tombe dans le vide, sans le moindre écho. En avançant dans le silence, nous restons égarés, le temps ne s'écoule pas - et pourtant nous oublions ; nous nous demandons à notre tour si les mots entendus n'ont jamais été vraiment prononcés, nous souhaitons qu'ils ne l'aient jamais été. La répétition implacable de l'appel devient insoutenable.
Et quand la réponse arrive, elle s'entend comme brusque, inattendue ; la gamme impatiente des émotions a déjà répandu ses fronces et ses plis dans notre esprit. Il nous semble alors, à nous spectateurs, il nous semble capter des éclairs de regards enchevêtrés, le bruit d'un sourcil qui monte, des yeux qui se ferment ensemble, la suspension de lèvres entr'ouvertes.
Une dramaturgie implicite à la musique. Plus que représentée, elle est souvent induite seulement dans les silences d'attente, entre une phrase et l'autre. Il est singulier qu'une même définition puisse servir aussi bien pour les éléments musicaux que pour les personnages de théâtre. La technique vocale que j'avais imaginée quand j'étais jeune, pour mon univers sonore, s'apparentait aux techniques traditionnellement répandues dans les différentes parties du monde, en particulier en Inde et en Mongolie, comme je devais ensuite le découvrir.
Mes compositions d'alors n'étaient pas des morceaux orientalistes ; au contraire, ces pièces naissaient des possibilités de la voix naturelle. Amples oscillations à gorge libre, sons polyphoniques, coups de glotte : j'exigeais de nos chanteurs des sauts impraticables, un contrôle hors du commun de leur organe vocal, bien loin de ce qu'enseignent les conservatoires.
C'est pour cette raison aussi que je ressentais le besoin de changer le traitement de la voix, tout en restreignant ma recherche dans les limites de la tradition européenne, ce qui m'a confronté à des potentialités très concrètes. J'ai donc cessé de plier la voix à des sons inhabituels ; je la prends telle qu'elle existe aujourd'hui, mais avec d'autres articulations : je la rends « inouïe » au moyen d'un lexique nouveau. Voici quels sont les principaux éléments qui viennent reconstituer mon univers vocal.
Pour le chant lyrique :
- messa di voce, tension vers un sommet à partir duquel étincelle une vocalise ou resplendit un mouvement (il existe des articulations similaires chez les oiseaux) :
- glissandi, parfois unis dans des cantilènes de ports de voix (très répandus dans la musique ethnique).
Pour les récitatifs :
- glissandi micro tonaux de mots très rapides.
Etant exclusivement chantés, ils provoquent une impression sans tempérament qui est typique de la parole. Les structures que je confie aujourd'hui à la voix sont des structures organiques et non des structures minérales. Ce sont les éléments d'une monodie absolue, sans harmonie, dont les intervalles sont générés de façon géométrique, avec des rapports fondés sur une identité reconnaissable.
L'absence d'accords que je recherche (les accords sont la glu qui soude la musique, toute musique) est une conséquence spécifique de la rigueur de mon choix de langage : une musique dans l'espace qui nous entoure, comme un système de gravitation, à trois dimensions et non plus à deux, formant un environnement vital dont nous enregistrons la présence.
12 madrigaux, loin de toute opération de récupération, mais sans être totalement étrangers à une vision historique, constituent un autre pas nécessaire ; il y a révélation progressive d'une nouvelle vocalité. Je voudrais rattacher à ce cycle un second volume, dans lequel des textes plus amples seront divisés en différents morceaux.
La multiplication des voix, dans un cadre strictement monodique, y laisse émerger une sorte de cercle sapiential ou à répons. La distribution et le rebond du texte deviennent signifiants, comme si le sujet poétique se réfractait en un groupe d'êtres, à la fois récepteurs et acteurs de stupeur devant le spectacle de la nature.
En introduisant dans des morceaux musicaux aux proportions moins étroites la fulguration verbale propre aux haïkus, les vers tournent sur eux-mêmes et le sens se retourne. Chaque mot entre en contact avec un autre, même s'il est éloigné, suscite de nouvelles images, réalise des court-circuits.