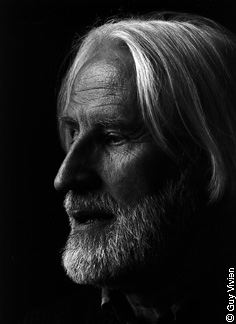Le point de départ est le dernier Concerto pour piano de Mozart, auquel je pensais sans cesse. Je voulais mettre en cause le développement inflationniste de la musique d’avant-garde. J’évitais volontairement les passages de virtuosité pianistique pour privilégier la polyphonie et la simplicité de l’atmosphère sonore.
Dans le premier mouvement de Intarsi, qui sera suivi par l’ultime tranquillité du second mouvement, le piano est lié dans un mouvement d’ensemble extrêmement doux et transparent dont la sonorité en devient l’aspect dominant. Comme de la marqueterie, de toutes petites « citations » du premier mouvement de Mozart remontent par-ci par-là : un trille descendant comme un « Adieu » toujours nouveau, toujours plus lourd. Ce Kammerkonzert, notamment le mouvement « Intarsi » est dédié à la mémoire de Witold Lutoslawski, dont la précieuse amitié reste pour moi irremplaçable. La pièce est également écrite pour Andràs Schiff.
Le second mouvement, « Pianto – Specchio di Memorie », est dans un certain sens une étude spectrale à huit voix, dont les hauteurs dérivent en permanence de constellations d’intervalles mozartiens (comme d’ailleurs dans la première partie). La pulsation incessante des sons est subdivisée par des proportions de nombres premiers et est interrompue par deux « Cadenze contrappuntistiche » évanescentes, dont le contrepoint est élaboré à partir des motifs intervalliques et rythmiques du Concerto de Mozart. La troisième « Cadence », absorbée par les pulsations, rappelle le thème mozartien du second mouvement.
Dans le troisième mouvement intitulé « Unità » on retrouve une situation totalement opposée. Je me permets de développer ad absurdum un thème du dernier mouvement du Concerto de Mozart le séquençant, inversant, rétrogradant dans une « chasse aux sourcières » qui tend constamment à l’unité sans jamais l’atteindre.
Dans l’épilogue « Giardino Arabo » je saisis à nouveau « l’étude spectrale » du second mouvement pour le conduire de la manière la plus douce vers sa fin. Une échelle en trois-quarts de ton ébauchée déjà dans le second mouvement se développe en un Maqâm qui prend peu à peu la place de l’image sonore tempérée du piano. Le « pianoforte », véritable fondement historique de notre pensée musicale chromatique, laisse la place à un monde sonore aux horizons différents.
|